 Grande nouvelle ! Paris-III et Paris-IV vont se remettre au travail, après des mois de chienlit, et à un mois de l’été…
Grande nouvelle ! Paris-III et Paris-IV vont se remettre au travail, après des mois de chienlit, et à un mois de l’été…
Mesure-t-on l’étendue du désastre ? La réforme de l’Université répondait à plusieurs exigences dont la première consistait à redonner leur place aux grands établissements d’enseignement supérieur français dans le rayonnement mondial, mesuré entre autre par le fameux classement de Shanghai dont les meilleurs sont tous anglo-saxons. La dérive technocratique française a tenu, selon sa bonne habitude de soviétisme prétendument réussi, à désigner nos universités par des villes et des numéros, alors que de l’autre côté de l’Atlantique on parle d’une manière beaucoup plus identifiable de Harvard, Stanford, Berkeley, Yale, Princeton, sans qu’il y ait de confusion possible sur des institutions à la fois très polyvalentes et pourtant riches chacune de leur personnalité.
Il a fallu que le nom le plus chargé d’histoire et de prestige dans la longue vie de l’université française depuis le Moyen-Age, la Sorbonne, soit accolé à des départements qui pendant de longues semaines ont avec constance dégradé un peu plus l’image de notre enseignement supérieur, en faisant douter de sa qualité, de son sérieux, tout simplement de son honnêteté puisqu’il s’est révélé incapable de répondre à l’attente des étudiants étrangers qui lui avaient fait confiance. La Sorbonne à travers le nom qu’elle porte détient une part de l’image de notre pays. Ce n’est pas seulement un bâtiment ou une institution, c’est un symbole. C’était hier celui de l’excellence de notre enseignement, de l’exigence de notre culture. C’est aujourd’hui plus que jamais le symbole de notre décadence, celle que suscite jour après jour une poignée de gauchistes, mêlant comme d’habitude la vanité de croire que leurs idées ont encore quelque crédit dans le monde, et l’irresponsabilité de refuser la réalité qui les entoure. Beaucoup de grands intellectuels français qui se sont lourdement trompés ont néanmoins continué à jouir d’une certaine renommée internationale à la mesure de leur narcissisme. Ils ont dilapidé un héritage qu’ils ne voulaient ni assumer ni faire fructifier. Désormais, il ne reste plus que des nains que le monde entier ignore, mais qui persévèrent à se croire des géants. L’irréalisme de l’université française n’a d’égal que son hypocrisie : la France est le seul pays du monde ou chaque élève de l’enseignement secondaire représente une dépense publique supérieure à celle d’un étudiant. Les grandes écoles échappent évidemment à cette catégorie, de même curieusement que les formations plus courtes comme celles données dans les IUT, mais on se garde bien de le dire… Ouverte à tous au nom de la démocratie, l’université française conduit plus de 50% des étudiants à l’échec en raison de l’insuffisance de la sélection et de l’encadrement.
Cette année, elle a fait mieux encore. Le plus souvent sous la pression d’éléments extérieurs qui ont profité du désarroi des étudiants et de la légèreté d’un certain nombre d’enseignants, une petite dizaine d’universités ont privé tous ceux qui s’y étaient inscrits des services auxquels ils avaient légitimement droit, l’enseignement, la préparation aux examens, et le passage de ceux-ci dans les délais et les conditions prévus. Aucune revendication sérieuse, aucune contestation légitime ne peut justifier dans une société démocratique, qu’une réforme voulue par le Gouvernement, votée par le Parlement, soit bloquée au mépris des intérêts réels de la jeunesse française. Vivant dans le mythe suicidaire de 1968, certains rejouent périodiquement cette comédie de la contestation violente de la loi, et la grande majorité, silencieuse comme toujours, accepte ce spectacle. Je pense en particulier à ces étudiants de Lille qui m’ont écrit pour dire leur déception après une année gâchée et leur angoisse de pouvoir passer leurs examens dans de bonnes conditions, de bénéficier ensuite de diplômes de valeur, reconnus et capables de les faire accéder à une vie professionnelle accomplie.
Face à la crise actuelle, l’enseignement supérieur, et donc la recherche, devraient être en pointe. Je me souviens du discours du Président de l’université de l’Arizona (université publique) disant que son but prioritaire était de contribuer à faire redescendre le niveau du chômage dans l’État au point où il en était avant la crise. Chez nous, il y a des présidents qui, entre deux textes philologiques abscons, s’en vont en voyage pendant que leur université poursuit sa grève…
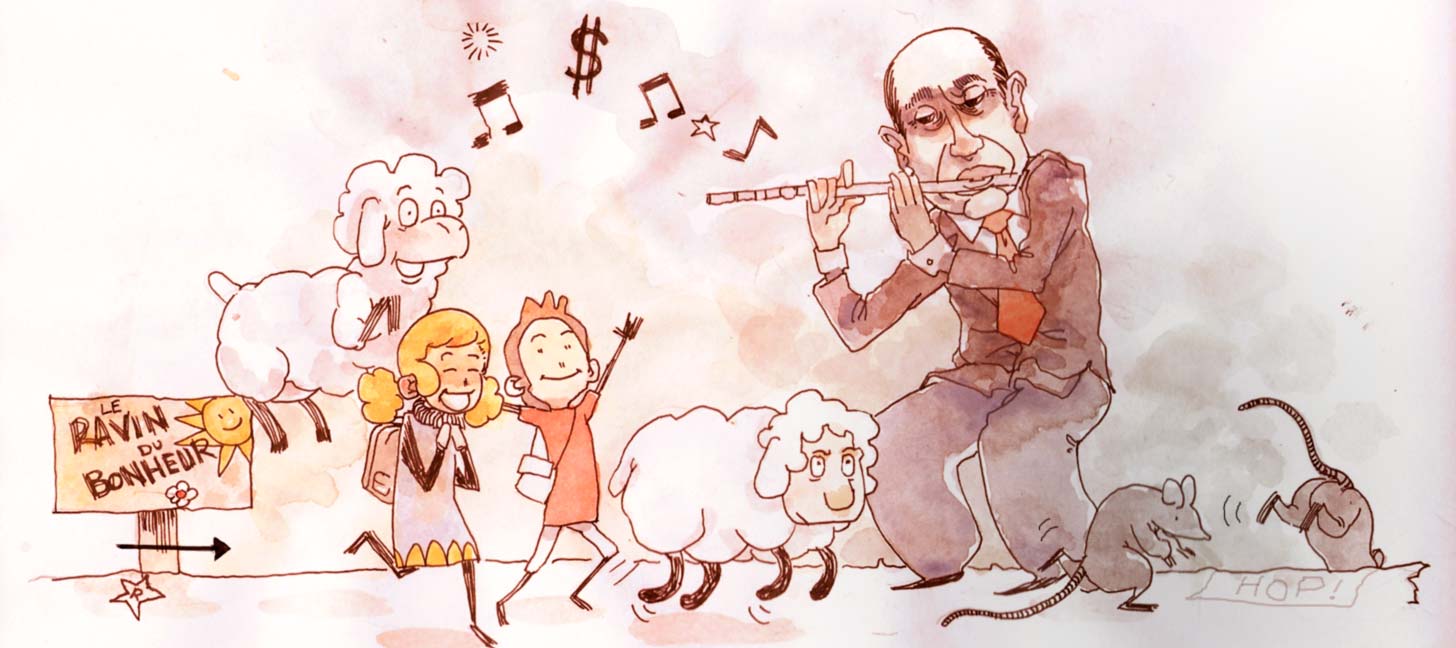



2 commentaires
“Aucune revendication sérieuse, aucune contestation légitime ne peut justifier dans une société démocratique, qu’une réforme voulue par le Gouvernement, votée par le Parlement, soit bloquée au mépris des intérêts réels de la jeunesse française.”
Monsieur Vanneste, ce n’est pas très sympa de ne pas tout nous dire.
Alors je vais le faire. La “réforme” dont vous parlez s’appelle le “processus de Bologne”. http://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_de_Bologne
Comme vous le savez pertinemment, cette “réforme” n’a pas été voulue par l’actuelle majorité, ni même par M. Sarkozy…Mais résulte d’engagements pris par d’anciens Ministres, dans le cadre de la construction européenne, sous des majorités différentes, qui elles mêmes n’avaient pas reçu mandat pour harmoniser notre système universitaire.
Mme Pecresse, en tant que Ministre de l’Enseignement Supérieur, met donc en oeuvre une série d’engagements, qui n’ont absolument pas été soumis à un quelconque avis d’une instance démocratique, ni le PE, ni le Parlement National n’ayant leur mot à dire sur le sujet. Le premier parce qu’il n’a pas les compétences pour ce faire, le deuxième parce qu’il “nationalise” des décisions prises en “haut”, sans discuter.
Savez vous qui est à l’initiative du processus de Bologne ? Le MEDEF version européenne. Depuis quand les instances patronales se préoccupent elles de nos “jeunes” ?
Bon, voyons un peu ce que prévoit ce processus de Bologne, dépourvu de la moindre onction démocratique, et contestable pour cette raison…Au moins.
Objectif : édifier un “espace européen de l’Enseignement Supérieur fort et compétitif à l’échelle mondiale, divers et convergent.”
“Cet objectif politique ambitieux nécessite que l’Europe se dote de pôles d’excellence mondiaux avec pour cela 2 exigences :
–Une augmentation substantielle du financement public et privé européen de l’enseignement supérieur et de la recherche.
–Une stratégie européanisée pour définir et construire ces pôles d’excellence européens.”
Le problème, voyez vous, M. Vanneste, c’est que nos universités n’ont pas l’intention d’être un “marché” et de laisser la politique de la recherche et de l’enseignement, devenir le jouet du MEDEF national ou européen…Comme l’est la politique migratoire (étrange, non, que personne n’ait songé à favoriser les naissances alors que l’on prône de partout l’immigration, choisie s’il vous plait, parce que tout de même ce serait bête d’accepter en France, des personnes non utiles pour le MEDEF)
Evidemment, cela crée des débats politiques majeurs pour l’avenir de l’université : l’évolution des missions de l’Université, l’autonomie des établissement et leur gouvernance, l’évaluation.
Je suppute que pour se doter de pôles d’excellence mondiaux (deux ou trois facs par pays, pas plus), il faudra bien faire ravaler leurs illusions de grandeur à toutes les facs de province miteuses qui s’imaginent assez bien pour tenir un rang mondial. Il est d’ailleurs important de faire le tri entre les mondialisables et les autres, puisque le privé étant appelé à financer de façon plus importante l’enseignement supérieur et la recherche, on ne va pas quand même pas faire perdre leur temps à des patrons qui ont autre chose à faire que de s’emm… avec des ploucs de chercheurs.
L’Université va devoir “entrer dans une logique de compétences” (ça va les changer ces bouseux de la fac, eux qui vivaient dans une logique de… De quoi au fait ? Nos universités n’ont pas attendu le capitalisme pour éclairer le monde, et même Saint Louis a reconnu la justesse des revendications de l’Université de Paris)
Entre autres, cette logique de compétences va nécessiter d'”identifier les compétences nécessaires pour s’adapter dans le monde du travail de demain (la mobilité, l’aptitude à la vie en réseau, la connaissance de son profil…)”
Moi j’adore la connaissance de son profil. On voit tout de suite que le mec qui va être jugé “bon pour l’usine” à 18 ans a intérêt à y rester.
Ensuite, il faudra savoir “acquérir des compétences transversales des formations initiales”
Je suis preneur d’un décodage de ce charabia. Je dois manquer de compétences mobiles !
Vous vous insurgez de voir la France résister ? Mais n’est ce pas légitime ? Et quand le Gouvernement, agissant en petit télégraphe du MEDEF européen, essaye de vendre un “modèle anglo saxon”…Sous pretexte qu’un jour un Ministre fantôme a apposé sa signature…N’est il pas normal que ceux qui font l’université…S’inquiètent, et se demandent si, mise à part la logique du profit, l’Université est vue comme quelque chose d’important ?
La France a résisté pendant des années à ce qu’on appellait le “modèle anglo saxon” celui là même qui a provoqué la crise que nous traversons ! Et c’est parce qu’elle a résisté à cette “modernité” qu’on voulait lui imposer…Que la France est dans une meilleure situation que ses partenaires, Allemands compris !
Vous vous interrogez sur l’impact de cette grève sur l’image de notre pays ? N. Sarkozy est moqué par l’ensemble de la presse internationale ! Deux poids deux mesures ?
En 2003, chacun y est allé de son couplet sur la mauvaise décision de M. Chirac. Au final, qui a eu raison ?
La France n’a peut être pas raison sur l’instant, mais le temps joue pour elle.
Pensez vous que les universitaires, les chercheurs, les étudiants, les parents d’élèves, etc. Se seraient unis contre la “loi Pécresse” et plus largement la privatisation de nos universités (visiblement perçues comme un marché pour le MEDEF) s’il n’y avait pas de raisons légitimes ?
Vous dénoncez parfois le mépris, l’ignorance, la suffisance, etc. Du Gouvernement à votre égard. Croyez vous qu’il soit plus acceptable de voir Mme Pecresse en campagne ? Au lieu d’être au travail ? De voir le mépris dont on entoure des universitaires qui ont dû effectivement s’attaquer à la Sorbonne, pour que l’on réagisse à “Paris'” ? Quel respect de la dignité des personnes ? Quel respect et écoute ?
La Déclaration dit bien que tout citoyen peut demander des comptes et participer à l’élaboration de la loi, bien sur en usant ses représentants, mais aussi par lui même.
Que font donc les universitaires, etc. Sinon demander le débat ? Un débat que Mme Pecresse leur refuse…Tant elle semble oublier son Ministère pour les régionales…De 2010 (sic !) On voit où sont ses priorités !
Depuis plus d’un quart de siècle, l’Université subit des réformes sans discontinuer, et sur tous les plans. A peine l’une est-elle digérée qu’une autre arrive, selon les caprices des ministres ou des directeurs de cabinet. L’universitaire passe son temps dans de la paperasse à réforme et de la réunion à réforme. Depuis plus d’un quart de siècle, il a tout avalé, tout accepté, sans un murmure, sans la moindre petite grève. Il a pris maints coups de pied au cul, et il a dit merci. Son métier s’est complètement dévalorisé, ses charges de travail n’ont cessé d’augmenter, ses conditions et ses lieux de travail sont à sangloter, il a avalé sans sourciller la démocratisation du supérieur, c’est-à-dire le quintuplement des effectifs en quelques lustres, tout cela en multipliant vaille que vaille les publications de haut niveau. Et voilà que pour une fois, pour une seule fois que l’universitaire élève la voix, on lui dit qu’il exagère et qu’on ne peut décidément pas réformer l’Université. Voudrait on qu’il applaudisse ?
La réforme Darcos des concours d’enseignement consiste, non pas à améliorer la formation des professeurs, comme on l’a malheureusement entendu régulièrement, mais avant tout à supprimer l’année de stage, c’est-à-dire ce qui jusqu’ici permettait réellement au jeune professeur d’apprendre son métier. Pourquoi cette suppression ? Pour faire des économies.
L’évaluation existe déjà, à tous les niveaux de la carrière d’un universitaire. Et ce que le ministère appelle évaluation n’est qu’une usine à gaz totalement irréaliste, destinée à récompenser les plus serviles, qui n’aboutirait, au prix d’une déperdition d’énergie monstrueuse, qu’à susciter une multiplication d’articles creux au lieu de favoriser la recherche fondamentale.
C’est un peu comme si on jugeait les députés au nombre de questions posées…Uniquement. Seriez vous renseignez sur le travail du député ? Non. Pourquoi le seriez vous plus concernant l’universitaire ?
La modulation des services n’est qu’une grosse astuce pour charger une bourrique universitaire qui croule déjà sous les tâches diverses, et finalement économiser sur les recrutements ou les heures supplémentaires, car tel est le véritable objectif. Il s’agit, par pure idéologie – mais aussi parce que les Ministres Français ont signé un protocole sur les services publics, qui doit être respectueux des AGCS – de transformer les universités en entreprises.
Bref, ce Il qu’on appelle “réforme” n’est en l’occurrence qu’une régression, une destruction du service public, de la part de politiques qui se moquent bien de l’Université et n’y connaissent rien. Ne serait ce que parce qu’eux mêmes n”y sont pas allés…Et n’y envoient pas leurs enfants, préférant de loin les “grandes écoles”. A commencer par Mme Pecresse et M. Darcos.
Classement de Shangai :
“Certes, les universités françaises sont mal classées, mais ce n’est pas qu’elles soient plus « médiocres » que les autres, c’est simplement que le monde académique français est organisé différemment du monde académique anglo-saxon. Des différences que le classement de Shanghai ne peut saisir. Son concepteur le reconnaît lui-même lors d’une conférence à l’IFRI à Paris : « du fait de la grande variété des types d’universités dans les différents pays du monde, il est difficile de les comparer avec justesse » (23/02/03). Suit une série d’arguments qui expliquent pourquoi les universités françaises sont disqualifiées, de fait, par la nature même des critères mobilisés pour établir le classement.
Premièrement, le classement s’intéresse aux publications en anglais dans des revues américaines, ce qui avantage grandement les pays anglophones au premier rang desquels les Etats-Unis. Deuxièmement, dans certains pays, comme en Angleterre, il y a une sélection des étudiants pour l’accès aux universités, ce qui n’est pas le cas en France, où celles-ci demeurent un service public d’accès universel. Troisièmement, selon les pays, les universités sont publiques ou privées, et n’ont donc ni le même budget (Harvard est ainsi cent fois plus riche que Paris VI), ni la même taille (il y a dix-sept universités à Paris, alors qu’il n’y en a que trois ou quatre dans d’autres grandes villes du monde). Quatrièmement, par les distinctions qu’il prend en compte (prix Nobel, médaille Fields), ce classement favorise les sciences dures et tend à faire des sciences humaines et sociales (SHS) des filières « non rentables »… du point de vue du classement évidemment.
Au rang des personnalités françaises ayant émis des critiques envers le classement de Shanghai, on ne manquera pas de citer Albert Fert, prix Nobel de physique en 2007, qui écrit dans Le Monde du 26 août 2008 un article intitulé «Comment le classement de Shanghai désavantage nos universités ». Son prix Nobel l’a amené à discuter avec des responsables du classement de Shanghai sur le bénéfice qu’allait en retirer son université Paris-XI. Il constate, par exemple, « qu’un prix, Nobel ou autre, obtenu par un professeur d’université française, rapporte deux fois moins de “points” à son université que le même prix en rapporte à l’université d’un collègue étranger, américain ou britannique. L’origine de cette réduction est la suivante. La recherche universitaire française s’effectue en général dans des laboratoires mixtes associant l’université à un organisme comme le CNRS. Shanghai attribue alors 50 % du bénéfice à l’université et 50 % à l’organisme ». Cette simple remarque d’Albert Fert nous donne ainsi une justification rationnelle (du point de vue du classement de Shanghai) du démantèlement actuel du CNRS : en le transformant en agence de moyens et en conférant aux universités autonomes le pilotage des laboratoires, celles-ci récupéreront l’ensemble des « points » qui leur sont dus. CQFD.
À l’aune du classement de Shanghai, la complexité du système institutionnel français n’apparaît plus comme une singularité, mais comme un handicap. Universités, grandes écoles, organismes de recherche (type CNRS) conduisent à une segmentation qui embrouille les statisticiens chinois, et qui ne leur permet pas de saisir la réalité française. Une difficulté qui pourrait finir par être surmontée par l’Observatoire des sciences et techniques (OST) qui a signé un accord de coopération de cinq ans avec l’université Jiao Tong visant à « obtenir une meilleure prise en compte des publications françaises dont le référencement complexe semble occasionner une perte de visibilité dans les classements internationaux ». À ce genre d’initiative qui vise à faire évoluer l’outil de l’intérieur, s’ajoute ce qu’il faut bien appeler une surenchère des classements.
Ces initiatives, critiques du classement de Shanghai, ont un point commun : elles ne mettent pas en question l’utilisation du classement. Pour Mohammed Harfi et Claude Matthieu, respectivement professeurs à Paris-XI et Paris-XII, le développement des classements internationaux est lié à la construction « d’une économie fondée sur la connaissance et sur l’ouverture à la concurrence internationale » qui soumet les systèmes nationaux à comparaisons et évaluations. La même idée se retrouve chez un autre professeur, d’économie à Paris-XI. Dans un article de la revue Futuribles, Bertrand Bellon se demande à propos de Shanghai, si ce classement est vraiment légitime, et conclut : « là n’est pas la question ». Il constate qu’« en quelques années, les classements se sont imposés dans le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur » et qu’« il faut donc faire avec ». En acceptant l’idée que l’enseignement supérieur et la recherche sont avant tout un rouage d’une économie de la connaissance, ces auteurs ne remettent pas en cause le fait même que des classements puissent « s’imposer ».
Contre cette vision instrumentale d’une éducation mise au service du marché du travail, et d’un savoir mis au service de l’innovation économique, un mouvement social, historique en France, s’élève actuellement chez les personnels de l’enseignement supérieur et la recherche. Par leur opposition au démantèlement du CNRS, par leur refus de « l’autonomie » des universités qui institutionnalise la mise en concurrence, par leur rejet des outils d’évaluation fondés uniquement sur des aspects quantitatifs, ces personnels rejettent des réformes qui, certes, faciliteront la montée de certaines universités françaises d’élite dans le classement de Shanghai, mais engendreront aussi (et en réalité surtout) un changement radical de logique.
Dans la nouvelle configuration, c’est la logique même de service public qui se voit remise en cause, au profit de la logique libérale et élitiste. Ce sont ainsi deux visions idéologiques du monde académique qui s’affrontent autour de conceptions différentes de ce que doit être l’« efficacité » d’un système d’enseignement supérieur et de recherche : d’un côté, être le moteur du progrès social et de l’autonomie individuelle et collective ; de l’autre, être le moteur du développement du capital humain et de l’innovation au sein d’un marché mondial de la connaissance. Le classement en tant qu’outil participe activement au développement de cette seconde conception.
Pour le comprendre on peut, par exemple, se référer au travail du sociologue Lucien Karpik sur ce qu’il nomme L’économie des singularités (NRF, Gallimard, 2007). Il y souligne l’importance prise par les « dispositifs de jugement » dans le cadre des marchés de biens culturel ou dans l’univers des services marchands. Une caractéristique fondamentale des biens culturels (livres, disques, films, etc.) et des services marchands (restaurants, artisans, etc.) est que leur qualité est par nature incertaine, en ce sens que cette qualité ne peut être connue du consommateur qu’après achat ou utilisation. Il y a donc, pour lui, un risque de déception. Pour le minimiser, et faire en sorte que le marché fonctionne quand même (c’est-à-dire que les consommateurs consomment), des «dispositifs de jugement » sont mis en place, qui peuvent prendre des formes variées, telles celles de chroniques dans les journaux, de guides, labels, réseaux ou marques, et bien sûr, de classements.
De cette analyse, on peut déduire que l’existence d’un classement des universités participe à la construction d’un « marché universitaire » dans lequel une offre, constituée d’universités mises en concurrence et hiérarchisées, cherche à attirer une demande, constituée d’étudiants appelés à choisir leur université, leur filière, leur diplôme, en fonction d’une rentabilité matérielle et symbolique future sur le marché du travail. Cette relation instrumentale entre universités et étudiants n’a rien de naturel. Et, ceux qui pensent qu’un classement ne fait que retranscrire une réalité préexistante succombent en fait à une vision idéologique du monde social (trop largement répandue chez nos élites), celle du néolibéralisme qui tend à considérer que toute relation sociale prend, naturellement, la forme d’un marché et se compose d’individus rationnels. Le système d’enseignement supérieur et de recherche français, organisé comme un service public vient démentir cette vision.
Bien que de nombreux mécanismes concurrentiels soient déjà à l’œuvre, certains piliers tels le statut de fonctionnaire des personnels, le montant conventionné des droits d’inscription, ou la non-sélection des étudiants à l’entrée des universités, renvoient toujours à l’idée de service public. Ces piliers sont évidemment menacés par la logique libérale, car ils entravent le déploiement des mécanismes concurrentiels. Ces mécanismes permettront, sans doute, à une élite d’une dizaine d’universités, au plus, de concentrer les succès et d’accéder à de meilleures positions dans le classement de Shanghai. Mais ils auront pour contrepartie de faire entrer les personnels dans un cercle vicieux de servitude volontaire. Le recours sans discernement à la bibliométrie (comptage du nombre d’article publiés, de fois où un article est cité, etc.) en est un bon exemple : elle va inciter les chercheurs à s’engager dans des recherches rentables à court terme et à privilégier les objectifs quantitatifs. Elle va peu à peu assécher la recherche fondamentale, décourager l’imagination et la prise de risque, détruire les subjectivités individuelles et les formes de coopération. Autrement dit, elle provoquera un effet inverse de celui escompté.
La récente débâcle du monde de la finance offre une démonstration parlante de l’échec de cette logique libérale. Livrée à elle-même, ne véhiculant aucun projet, et n’ayant aucune autre boussole que celle de la maximisation du profit individuel, la finance a fini par s’emballer, produisant pour elle-même ses propres « dispositifs de jugement ». Et ce sont les agences de notation privées, principales productrices de critères financiers, qui ont fini par créer la « bombe à retardement » des subprimes. Les mécanismes concurrentiels et de servitude volontaire à l’œuvre avaient engendré, chez les acteurs financiers, la perte du sens de leur activité, et provoqué chez eux l’inconscience des enjeux simplement éthiques. Dans le monde universitaire et scientifique aussi, à l’heure des techno-sciences et des nanotechnologies, des questions essentielles se posent. Mais, le classement de Shanghai n’y répond en rien et il ne véhicule, là encore, aucun projet. Il est donc urgent que la marche libérale soit brisée, et qu’un véritable débat puisse s’enclencher, non plus, comme à Bologne et Lisbonne, sur une «économie de la connaissance », mais sur la place de la connaissance (enseignement et recherche scientifique) dans nos sociétés, et sur les rapports qu’elle doit entretenir avec l’économie (capitaliste).
Chacun se met à imaginer de nouveaux critères censés être plus objectifs et refléter mieux la réalité des systèmes d’enseignement supérieur et de recherche mondiaux. Un rapport du sénateur UMP de l’Eure, Joël Bourdin, datant du 2 juillet 2008 montre que toute tentative de classement possède d’importantes limites et manifeste la fâcheuse tendance à valoriser systématiquement les universités de certains pays : de même que le classement de Shanghai est très favorable aux universités américaines, le classement anglais favorise les performances des établissements du Royaume-Uni, le classement de Leiden donne de belles places aux universités néerlandaises, et celui de l’Ecole des Mines favorise les grandes écoles françaises.” (Julien Decire)
Au passage, ledit classement est tout simplement ignoré en Amérique du Nord (E-U et Canada) et le chercheur canadien Yves Gingras, spécialiste de l’évaluation bibliométrique explique : « Censé constituer la référence internationale en matière de palmarès des universités, le classement de Shanghai est un outil du pouvoir chinois à usage essentiellement interne, complaisamment repris par la presse européenne, largement ignoré aux États-unis […] il sert aussi de façon stratégique les acteurs qui veulent réformer le système universitaire et se servent de ces classements de façon opportuniste pour justifier leur politique » (Marianne 2, juin 2008). Pour s’en convaincre cet article du Figaro du 19 juin 2007 : « Voilà un classement qui tombe à pic. Alors que le gouvernement doit présenter en fin de semaine son projet de réforme de l’université, censé rendre nos campus plus compétitifs, une nouvelle versiondu célèbre palmarès de Shanghai vient rappeler que la France ne brille pas sur la scène universitaire internationale ».
Malgré les réserves formulées, le classement de Shanghai par pays fait apparaître la France au 6e rang mondial, avec 21 de ses 85 universités classées dans les 500 premières universités mondiales. D’autres classements utilisant des critères différents placent la France dans les tout premiers rangs mondiaux : le classement de l’École des Mines de Paris utilisant comme critère le lieu de formation des chefs des entreprises mondiales les plus importantes place la France en
position (derrière les États-Unis et le Japon) ; un autre qui prend en compte la concentration géographique des performances en adoptant comme référentiel la superficie du campus d’Harvard (1ère université dans la plupart de classements) montre qu’en intégrant toutes les universités, écoles, instituts de recherche et laboratoires du quartier latin à Paris sur une même superficie que le campus d’Harvard, la France obtiendrait le 1er rang dans un classement utilisant les mêmes critères que le classement de Shanghai.
Si l’on cherche à déplacer le problème de ces classements, dont la pertinence reste contestable, en posant la question de l’attractivité des établissements d’enseignement supérieur français dans le monde, l’enquête de l’OCDE montre que la France se place au 4e rang mondial. Les États-Unis, le Royaume-Uni (les deux favorisés par la langue anglaise) puis l’Allemagne, et la France accueillent plus de 50 % de tous les étudiants étrangers.
Notons que la France est le seul pays parmi les 5 premiers à avoir vu son attractivité augmenter (d’un point) entre 2000 et 2006, quand les autres ont stagné, voire pour les États-Unis ont observé une chute de près de 5 points. Notons enfin que selon le rapport du Ministère lui-même (état du sup) l’attractivité des universités françaises sur les étudiants étrangers est d’autant plus forte que les diplômes convoités sont élevés : les universités françaises attirent donc davantage à haut niveau de formation, essentiellement au niveau du Master et du Doctorat.
Le rayonnement du système universitaire français assure donc une attractivité mondiale réelle et qui va totalement à l’encontre des discours«déclinistes ». Cette position plus qu’honorable est notamment rendue possible par unepolitique d’investissement culturel à l’étranger qui est aussi géostratégique : or, ces derniers mois ont vu une remise en cause financière et structurelle de nombreux instituts français à l’étranger,comme le centre Marc Bloch à Berlin (http://www.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article2293 ), l’Institut Français d’Études Anatoliennes d’Istanbul (http://www.mesopinions.com/Une-nouv… ), soulevant l’indignation de la communauté scientifique internationale.
Bref, faisons notre propre classement, çà ira plus vite, et pas besoin de faire des réformes idiotes !
Nos Universités sont en concurrence depuis très longtemps, et sans avoir attendu le grand capital. Pourquoi les briser au lieu de les aider ?
Pour en savoir plus sur les perspectives pour nos universités, je vous invite à lire le programme de travail de la Présidence tchèque de l’Union Européenne qui est, très clairement, un programme de privatisation de la recherche et de l’éducation. La situation en Europe risque de devenir globalement bien pire qu’aux Etats-Unis, avec l’application du Traité de Lisbonne.